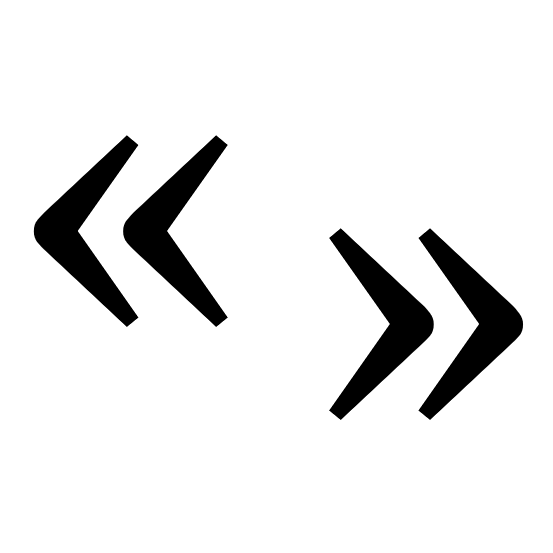Le renard en sait beaucoup…
«
Le renard en sait beaucoup, mais celui qui le prend en sait davantage.
»
Maurice Maloux, dans son Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, nous apprend que cette phrase proverbiale1 nous vient d’une nouvelle de Cervantès, « Le petit-fils de Sancho Panza », issue des Nouvelles exemplaires. Si l’on consulte ledit ouvrage, on y trouve en effet notre adage, parmi de nombreux autres :
Mieux vaut bonne espérance que mauvaise possession.
Le renard en sait long, mais plus long celui qui l’attrape.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Cervantès, Les Nouvelles, éd. et trad. Louis Viardot, nouvelle éd., p. 248.
Pourtant, l’original espagnol ne compte aucun de ces adages. On en découvre l’explication dans la préface du traducteur, Louis Viardot :
« Aujourd’hui je vais prendre exemple sur Le Sage, et, m’emparant du cadre adopté par Cervantès, dont je donnerai une traduction libre et abrégée, je remplirai ce cadre par une matière nouvelle, non de mon invention toutefois, mais empruntée au même pays, à toutes ses provinces et en quelque sorte à tous ses habitants. En un mot, au lieu des intraduisibles lazzi que prête Cervantès au fou raisonnable de sa nouvelle, j’emprunterai les proverbes de l’Espagne, et le Licencié Vidriera s’appellera le Petit-fils de Sancho Panza. Dans cette espèce d’habit d’arlequin, il n’y aura de moi que la couture2. »
Louis Viardot, Préface du traducteur, dans ibid., id., p. iii.
Le critique littéraire chilien Julio Saavedra Molina dit qu’il s’agit moins d’une traduction que d’une imitation, dans laquelle Viardot a introduit des proverbes espagnols, mais aussi des maximes empruntées à La Rochefoucauld et Schopenhauer ! Et de conclure, à la suite de Raymond Foulché-Delbosc3, que les maximes du « Petit-fils de Sancho Panza » n’ont rien à voir avec celles du « Licencié de verre »4.
Faut-il donc se résoudre à ne pas faire de Cervantès l’auteur de notre citation ? Peut-être pas, car en 1874 paraissent les Varias obras inéditas, attribuées à l’écrivain espagnol, parmi lesquelles les Entremés de refranes :
Vuesa merced se quede con Dios, que á puerta cerrada el diablo se vuelve. No quiero más perro con cencerro ; pero advierta que de lo contado come el lobo, y que aunque más sabe la zorra, más sabe el que la toma.
Que votre Grâce reste avec Dieu, car, devant une porte fermée, le diable s’en retourne. On ne prend pas les lièvres au son du tambour, mais sachez que, brebis comptées, le loup les mange, et, même si le renard en sait beaucoup, celui qui le prend en sait davantage.
Cervantès, Entremés de refranes, dans Varias obras inéditas, p. 117 ; notre trad.
Or il se trouve que l’éditeur de ces Varias obras inéditas, Adolfo de Castro, s’est lui-même rendu coupable de faux littéraires qu’il a prêtés à Cervantès. Très vite, des chercheurs nient l’attribution des Entremés de refranes à Cervantès. Il en sera de même au xxe siècle et encore aujourd’hui. On ne saurait donc attribuer notre phrase au célèbre auteur espagnol. Celle-ci se relève sous sa forme moderne en 16225 :
Muestra, que si mucho sabe la zorra, mas sabe quien la toma.
Cela montre que, si le renard en sait beaucoup, celui qui le prend en sait plus6.
Jéronimo Bautista Lanuza, Homilias sobre los Evangelios que la Iglesia santa propone los dias de la Quaresma, vol. III, 43, 2 ; notre trad.
Cependant, on trouve déjà en 1502 au sein du roman dialogué La Célestine :
[…] si sabe mucho la raposa : mas el que la toma […].
[…] si le renard en sait beaucoup, celui qui le prend en sait bien davantage7.
Fernando de Rojas, Tragicomedia de Calisto y Melibea, p. 75 ro ; trad. Alfred Germond de Lavigne, La Célestine, XIX, p. 257-258.
Ce proverbe, qui existe aussi, à la suite de l’espagnol, dans bien d’autres langues8, a des origines fort anciennes, puisque l’on note déjà chez Archiloque, poète du viie siècle av. J.‑C. :
πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἓν μέγα
Il sait bien des tours, le renard. Le hérisson n’en connaît qu’un, mais il est fameux.
Archiloque, « Épodes », II, 177, dans Fragments.
Ce fragment est lui-même un emprunt au Margitès9, poème comique du viii-viie siècle av. J.‑C. qui a longtemps été prêté à Homère. Plus de deux mille ans séparent ainsi l’attribution de notre formule à Cervantès et ses origines dans le Margitès !
Notes
1. « Le renard en sait long, mais celui qui le prend en sait un peu plus », pour le Dictionnaire de proverbes et dictons (« Proverbes du monde », 394), qui ne mentionne pas Cervantès. On donne parfois pour équivalent français Tel est pris qui croyait prendre.
2. Vingt ans plus tôt, dans sa première traduction des Nouvelles exemplaires, Viardot annonçait dans sa préface pourquoi il avait renoncé à traduire « El licenciado Vidriera » (« Le petit-fils de Sancho Panza ») :
« Cependant, une nouvelle du recueil original, le Licencié Vidriera, manquera à la copie française, et je crois devoir exposer le motif de cette suppression forcée. […] C’est comme un feu roulant de jeux de mots, de lazzi, de calembours, aussi bien en latin qu’en espagnol. Pour transporter dans notre langue un tel sujet avec tous ses détails, il n’y avait que deux partis à prendre : ou rester traducteur, et alors chaque phrase exigeait un vrai commentaire, des notes beaucoup plus longues que le texte, ce qui aurait rendu insupportable une lecture devenue d’ailleurs sans utilité ; ou se faire imitateur […]. J’ai pris, comme dit Montaigne, un tiers chemin pour sortir d’embarras. Je n’ai ni traduit ni imité. »
Louis Viardot, Préface du traducteur, dans Cervantès, Les Nouvelles, p. 3-4.
3. Préface, dans Cervantès, Le Licencié Vidriera, p. 33.
4. Sobre un plagio de La Rochefoucauld a Cervantes, p. 7. Le texte est à ce point difficile à traduire qu’il est parfois exclu des Nouvelles exemplaires. En 1857, Charles Romey annonce ainsi dans la Revue française qu’il est le premier à réussir cette prouesse*. Non seulement, il est loin d’être le premier, mais de surcroît sa version est jugée médiocre par Raymond Foulché-Delbosc**. Il faut dire que dès 1615 François de Rosset francisait la nouvelle. Cependant, la traduction n’était pas fidèle et comportait même des inexactitudes. Certains de ses successeurs vont donc préférer une adaptation à une traduction***. Au xviiie siècle, « Le licencié de verre » se trouve souvent expulsé des Nouvelles de Cervantès****. De nouvelles tentatives suivront, qui seront toujours jugées aussi durement*****.
* « Nous avons essayé de traduire le Licencié Vidriera ou de Verre, que M. Viardot, dans la préface de sa version française des Nouvelles de Cervantes, a déclaré intraduisible. C’est la première fois qu’on tente de faire passer dans notre langue cette nouvelle qui a effrayé tous les traducteurs, et qui doit paraître dans une édition des Nouvelles de Cervantes que publieront prochainement les éditeurs Poulet-Malassis et de Broise » (Charles Romey, note à Cervantès, « Le licencié Vidriera : nouvelle traduite, pour la première fois, de Cervantes », dans Revue française, 3e année, vol. XI, p. 448-468).
** Foulché-Delbosc, s’étant fondé sur l’édition de Romey de 1862, a ironisé sur la prétention de celui-ci, qui, même s’il n’était pas le premier traducteur, a néanmoins publié sa version un an avant celle de Viardot.
*** C’est ainsi que Charles Cotolendi expliquait en 1678 dans la préface des Nouvelles de Cervantès : « Dans la Nouvelle du Docteur Vidriera, il y a beaucoup de réponses qu’il fait, que je n’ay pas mises ; elles sont si fades en nôtre Langue, que quand je les ay leuës aux personnes que j’ay consultées, on ne les a pû souffrir. Je les ay donc ôtées, & en ay mis d’autres, peut-estre ne valent-elles pas mieux ; mais je n’ay fait cela que par le sentiment de gens extrémement éclairez » (Préface, dans Cervantès, Les Nouvelles, vol. I, n. p.).
**** Le traducteur de l’édition d’Étienne Lucas en 1720, identifié — sans doute à tort — à l’abbé Martin de Chassonville, déclare ainsi dans son avertissement : « Jai cru que ce seroit faire plaisir au Public d’entreprendre une nouvelle traduction de ces Avantures. Je l’ai fait à deux Nouvelles près, qui ne font nullement du goût de nôtre Nation, & auxquelles il n’étoit pas possible de donner le tour qu’on a donné aux autres » (Avertissement du traducteur, dans Cervantès, Nouvelles, vol. I, n. p.). En 1744, Martin de Chassonville est cette fois le traducteur authentifié de l’édition de Marc-Michel Bousquet, s’annonçant comme « augmentée de trois nouvelles qui n’avoient point été traduites en François [sic] ». Le libraire affirme : « J’avois remarqué avec peine, que celles que nous avons, ne sont ni correctes, ni complettes, par la faute des Traducteurs, qui se sont faussement imaginé, qu’on ne pouvoit traduire en François plusieurs Nouvelles de notre Auteur, sans blesser la délicatesse de cette Langue, & sans courrir risque de ne se point faire entendre. Crainte mal fondée, selon moi, qui a privé les Amateurs des Productions du vafte génie de Cervantes, de trois de ses plus belles & plus amusantes Nouvelles, telles que sont celles, de Rinconnet & Cortadille, du Licentié Vidriera ou de Verre, & du Curieux Impertinent » (Avertissement du libraire sur cette nouvelle édition, dans Cervantès, Nouvelles exemplaires, vol. I, p. iii-iv).
***** Celle de Viardot (cf. supra) puis celle de Jean Cassou : « Le principal reproche que l’on pourrait faire à la traduction des Nouvelles exemplaires par Jean Cassou, […] c’est justement qu’elle représente souvent, du point de vue philologique, une régression par rapport à Viardot et Rosset : moins précise, moins expressive, elliptique, voire franchement erronée » (Robin Lefere, « La traduction française des Novelas ejemplares : réflexions sur une trajectoire », Livius, no 3, p. 190).
5. Elle figure dans un recueil d’adages de Gonzalo Correas :
« Mucho sabe la zorra, pero mas el ke la toma. / Añaden dos pullas [:] kornudo vaias a Rroma, o kagaxon en tu boka. Kornudo por hod[ido]. »
« Le renard en sait beaucoup, celui qui le prend en sait encore plus. On ajoute deux plaisanteries grossières : cocu, va à Rome ou de la merde dans ta bouche. Cocu au sens de “baisé”, “foutu”. »
Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales [ms. 4450], fo 749 ; notre trad.
Il faut savoir que zorra a aussi le sens de « prostituée », ce qui explique les références salaces.
6. On trouve chez Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme : « Ces femmes ont tant de ruses : car, comme dit l’Espagnol, mucho sabe la zorra, pero sabe mas la Dama enamorada : c’est à dire : le renard sçait beaucoup, mais une Dame amoureuse sçait bien davantage » (Les Vies des dames galantes de son temps, vol. II, p. 186). Sur le sens de zorra, cf. la note précédente.
7. La première traduction de La Célestine, en 1527, indique : « Et si le regnard scet beaucoup de malice, plus scet celluy qui le prent […] » (Fernando de Rojas, Celestine, p. [320]).
8. Cf. Instituto Cervantes, « Mucho sabe la zorra, pero más el que la toma », « Refranero Multilingüe », dans Centro Virtual Cervantes [en ligne] et « Fox », 8, dans The Macmillan Book of Proverbs, Maxims, and Famous Phrases.
9. Cf. Pseudo-Homère, Margite, 5.
Sources
- Archiloque, Fragments, éd. François Lasserre et André Bonnard, trad. André Bonnard, Paris, Les Belles Lettres (« Collection des universités de France »), 1958.
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes [en ligne], Centro Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, s. d. [consulté le 11 juillet 2025].
- Brantôme (Pierre de Bourdeille, seigneur de), Les Vies des Dames Galantes de son temps, 2 vol., Leyde, Jean Sambix le Jeune, 1666 ; Memoires.
- Brantôme (Pierre de Bourdeille, seigneur de), Œuvres complètes, éd. Prosper Mérimée et Louis Lacour de La Pijardière, 13 vol., Paris, Plon, 1858-1895.
- Cervantès, « “Le renard en sait beaucoup, mais celui qui le prend en sait davantage” », « Citations », Le Figaroscope [en ligne], s. d. [consulté le 11 juillet 2025].
- Cervantès, Novelas ejemplares, Madrid, Juan de La Cuesta, 1613.
- Cervantès, El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, 2 vol., Madrid, Juan de la Cuesta, 1605-1615.
- Cervantès, Les Nouvelles, trad. Charles Cotolendi, 2 vol., Paris, Claude Barbin, 1678.
- Cervantès, Nouvelles, trad. anonyme, 3e éd. augmentée, 2 vol., Amsterdam, N. Étienne Lucas, 1720.
- Cervantès, Nouvelles exemplaires, trad. Martin de Chassonville, éd. nouvelle et augmentée, 2 vol., Lausanne/Genève, Marc-Mic. Bousquet et Cie, 1744.
- Cervantès, Les Nouvelles, éd. et trad. Louis Viardot, 2 t. en 1 vol., Paris, J.‑J. Dubochet et Cie, 1838.
- Cervantès, Le Licencié Vidriera : nouvelle traduite, pour la première fois, de Cervantes, trad. Charles Romey, dans Revue française, 1857, 3e année, vol. XI, p. 448-468.
- Cervantès, Les Nouvelles, éd. et trad. Louis Viardot, nouvelle éd., Paris, Hachette et Cie, 1858.
- Cervantès, Varias obras inéditas, éd. Adolfo de Castro, Madrid, A. de Carlos é hijo, 1874.
- Cervantès, Le Licencié Vidriera, éd. et trad. Raymond Foulché-Delbosc, Paris, H. Welter, 1892.
- Cervantès, Nouvelles exemplaires, éd. et trad. Jean Cassou, [Paris], Gallimard (coll. « Folio classique »), DL 1981.
- Cervantès, Nouvelles exemplaires, trad. Louis Viardot, Paris, POL (coll. « La Collection »), DL 1992.
- Cervantès, « Nouvelles exemplaires » suivies de « Persilès », sous la dir. de Jean Canavaggio, [Paris], Gallimard (coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), DL 2001 ; Œuvres romanesques complètes, vol. II.
- Correas (Gonzalo), Vocabulario de refranes y frases proverbiales [ms. 4450], Madrid, Biblioteca nacional de España, xviie siècle.
- Correas (Gonzalo), Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), éd. Louis Combet, Bordeaux, Institut d’études ibériques et ibéro-américaines de l’université de Bordeaux, 1967.
- Dag’Naud (Alain) et Dazat (Olivier), Dictionnaire (inattendu) des citations, [Bagneux], Le Livre de Paris / [Paris], Hachette, 1983.
- Dictionnaire de proverbes et dictons, éd. Florence Montreynaud, Agnès Pierron et François Suzzoni, Paris, Dictionnaires Le Robert (coll. « Les Usuels »), DL 1994.
- Fragmentos de épica griega arcaica, éd. et trad. Alberto Bernabé Pajares, Madrid, Editorial Gredos, (coll. « Biblioteca clásica Gredos »), DL 1979.
- Garmendia (Vincent), De Madrid al cielo : dictionnaire des expressions espagnoles avec toponyme et leur équivalent français, Saint-Denis, Éditions Connaissances et Savoirs (coll. « Lettres et Langues », série « Espagnol »), DL 2016.
- Instituto Cervantes, Centro virtual Cervantes, Instituto Cervantes, [en ligne], Instituto Cervantes, cop. 1997-2025 [consulté le 11 juillet 2025].
- Lanuza (Jéronimo Bautista), Homilias sobre los Evangelios que la Iglesia santa propone los dias de la Quaresma, Impressas, 3 vol., Barbastro, Sebastian Matevad, 1622.
- Lefere (Robin), « La traduction française des Novelas ejemplares : réflexions sur une trajectoire », Livius : revista de estudios de traducción, 1993, no 3, p. 185-196.
- Macmillan Book of Proverbs, Maxims, and Famous Phrases (The), éd. Burton Egbert Stevenson, New York (N. Y.), Macmillan Publishing Company, cop. 1976.
- Maloux (Maurice), Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Paris, Larousse (coll. « Références Larousse », série « Langue française »), DL 1980 (éd. 1991).
- Martínez de Carnero, (Fernand), Γνώμη : I luoghi comuni del linguaggio [en ligne], Gnomê, cop. 2008 [consulté le 13 mai 2025].
- Pàmies i Riudor (Víctor), Paremiologia catalana comparada digital [en ligne], Víctor Pàmies i Riudor, cop. 2020-2025 [consulté le 14 juillet 2025].
- Pseudo-Homère, Margite, éd. et trad. Antonietta Gostoli, Pise/Rome, Fabrizio Serra (coll. « Testi e commenti »), 2007.
- Rojas (Fernando de), Tragicomedia de Calisto y Melibea, Séville, s. n., 1502.
- Rojas (Fernando de), Celestine en laquelle est traicte des deceptions des serviteurs envers leurs maistres, et des macquerelles envers les amoureux translate dytalien en françois, Paris, Galliot Du Pré, 1527.
- Rojas (Fernando de), La Célestine : tragi-comédie de Calixte et Mélibée, éd. et trad. Alfred Germond de Lavigne, Paris, Charles Gosselin, 1841.
- Romey (Charles), Voyage à travers mes livres : lectures pour tous, Paris, Morizot, 1862.
- Ruiz Urbón (Cristina), « Los diez entremeses atribuidos a Miguel de Cervantes Saavedra : historia crítica y estado de la cuestión », Anales Cervantinos, 2023, vol. LV, p. 211-244.
- Saavedra Molina (Julio), Sobre un plagio de La Rochefoucauld a Cervantes, Santiago du Chili, Impresa universitaria, 1935.
- Société des gens de lettres, Babel : publication de la Société des gens de lettres, 3 vol., Paris, Jules Renouard et Cie, 1840.
- Ten Spanish Farces of the 16th, 17th and 18th Centuries, éd. George Tyler Northup, Boston/New York/Chicago, Heath and Co. (coll. « Heath’s Modern Language Series »), cop. 1922.
Mots-clés